Une approche de médecine systémique pour aborder les problèmes liés au diagnostic précoce et à la stratification pronostique du mycosis fongoïde
Ce « fonds affecté » a été attribué à la Prof. Emmanuelle Guenova (CHUV) en janvier 2024 pour une durée de 18 mois.
Le dépistage précoce et un diagnostic précis sont des stratégies clés dans la lutte contre la mortalité due au cancer. Particulièrement au stade précoce, le mycosis fongoïde (MF), à savoir le lymphome cutané à cellules T le plus répandu, présente des similitudes morphologiques frappantes avec certaines affections cutanées inflammatoires bénignes. Il en résulte deux problèmes importants : un diagnostic tardif et un pronostic incertain. Nous proposons donc un vaste effort interdisciplinaire combinant la bioinformatique, la recherche biologique et la médecine pour aborder les difficultés liées au diagnostic précoce et à la stratification pronostique de tumeurs telles que le MF. Cette initiative de recherche indo-suisse nous offre la possibilité exceptionnelle de comparer le MF classique et la forme hypopigmentée, une variante distincte rare dont le pronostic est très différent de celui de la maladie classique. Nous postulons que l’immunité de type 2 joue un rôle clé dans la progression du MF. Nous pensons en outre que la variante hypopigmentée du MF, qui existe à l’état naturel et présente un bon pronostic et une forte immunité de type 1, peut servir de comparateur approprié pour le phénotype classique du MF. Nous espérons ainsi élucider la complexité de la maladie, identifier les régulateurs immunitaires négatifs et définir des paramètres pour une meilleure classification et stratification des patients atteints du MF.
Elucidation des règles d’identification des épitopes propres au cancer par les lymphocytes T
Ce « fonds affecté » a été attribué au Prof. David Gfeller en juillet 2024 pour une durée d’une année.
Dans l’immunothérapie des cancers, les lymphocytes T jouent un rôle essentiel, car ils sont capables de cibler et d’attaquer les cellules cancéreuses. Pour ce faire, ils doivent reconnaître des molécules spécifiques, appelées épitopes, présentes sur les cellules cancéreuses, mais absentes à la surface des cellules saines. De manière à maximiser la probabilité de détecter la grande variété d’épitopes présents dans les patients atteints d’un cancer, différents lymphocytes T sont pourvus de récepteurs différents. Les récepteurs des lymphocytes T aptes à reconnaître les épitopes propres au cancer sont prometteurs pour les applications thérapeutiques, vu qu’il est possible de modifier les lymphocytes T de manière à ce qu’ils expriment ces récepteurs et ensuite d’administrer ces cellules modifiées au patient.
La technologie actuelle permet de mieux en mieux d’identifier les différents récepteurs des lymphocytes T et les épitopes présents dans les tumeurs. Cependant, il est encore très difficile de déterminer quel lymphocyte T reconnaît quel épitope.
Dans le cadre de notre projet, nous combinerons méthodes expérimentales et informatiques pour caractériser la reconnaissance par les récepteurs des lymphocytes T des épitopes propres au cancer. Nous visons ensuite à développer des modèles basés sur l’intelligence artificielle, qui serviront à analyser d’importantes collections de récepteurs des lymphocytes T issus de patients. Le but sera de sélectionner les plus prometteurs pour une application clinique. Ces résultats viendront compléter les recherches en cours au département d’oncologie et ailleurs. Ils contribueront ainsi à accélérer et à rationaliser les pipelines actuels, afin de prioriser la sélection des récepteurs les mieux adaptés auxthérapies à base de lymphocytes T.
Thérapie miroir pour le traitement du syndrome du sein fantôme
Ce « fonds affecté » a été attribué au Dr Filipe Martins (EPFL) en février 2024 pour une durée d’une année.
Le cancer du sein est le cancer le plus fréquemment diagnostiqué chez la femme, avec plus de 6000 nouveaux cas par année en Suisse, et l’incidence continue d’augmenter. Bien que le cancer du sein reste l’une des principales causes de décès liés au cancer1,2, la mortalité due à cette maladie a considérablement diminué au cours des dernières décennies1,2, notamment grâce à la mise en œuvre de programmes de dépistage par mammographie, des améliorations au niveau de la chirurgie et des traitements médicaux plus efficaces.
Environ 40% des patientes atteintes d’un cancer du sein doivent subir une mastectomie3. Une gestion adéquate des conséquences à long terme de cette intervention chirurgicale est donc préconisée, dans le but, d’une part, de limiter les impacts économiques et sociétaux de la morbidité s’y rapportant et, d’autre part, d’améliorer la qualité de vie des survivantes.
Le syndrome du sein fantôme (SSF), pouvant survenir après une mastectomie, est une affection similaire au syndrome du membre fantôme suite à une amputation, caractérisée par une sensation résiduelle associée au tissu mammaire amputé, et accompagnée de douleurs neuropathiques. Bien que l’incidence citée dans la littérature varie, la prévalence du SSF atteint jusqu’à 30% chez les patientes ayant dû subir cette procédure3. En conséquence, 760 femmes sont diagnostiquées chaque année en Suisse. Outre les sensations douloureuses décrites comme étant lancinantes ou brulantes, les patientes peuvent également ressentir d’autres désagréments tels que des picotements, des démangeaisons, des fourmillements, une pression ou des douleurs palpitantes3. En raison du handicap physique et de la détresse émotionnelle qu’il engendre, le SSF pèse considérablement sur la qualité de vie. Certaines études ont démontré que les dépressions, la morbidité psychiatrique et la peur d’une récidive du cancer sont plus prononcées chez les femmes souffrant du SSF3.
Il existe certaines similarités entre le SSF et le syndrome du membre fantôme, notamment en ce qui concerne le moment de leur apparition après l’intervention chirurgicale. Certains indices suggèrent en outre que leurs développements reposent sur la même base neurologique. Les recherches sur le SSF sont encore peu nombreuses et souvent peu concluantes. Cependant, il apparaît de plus en plus clairement que cette affection présente des caractéristiques particulières. Les interventions thérapeutiques pour ce type de douleur font appel à des médicaments oraux, tels que les opiacés et les antidépresseurs, ainsi qu’à des agents topiques. Ces traitements présentent toutefois une efficacité limitée une fois que la douleur chronique s’est installée. De même, il n’existe pas, à l’heure actuelle, de traitement préventif visant à réduire l’incidence du SSF. Les patientes s’en retrouvent souvent isolées, car la conscience de l’existence du SSF est très limitée en dehors de la communauté médicale spécialisée dans ce domaine. Il est donc urgent de mettre en place une gestion adéquate de ce syndrome.
Dans cette étude, nous visons à adapter au soin des patientes atteintes de SSF la « thérapie miroir », une méthode non invasive couramment utilisée dans le traitement du syndrome du membre fantôme. Cette thérapie, appliquée depuis le milieu du XXe siècle4,5, repose sur l’utilisation d’un miroir pour cacher le membre amputé et en remplacer l’image par le reflet du membre opposé intact. Le cerveau du patient est ainsi trompé par une perception visuelle de deux membres fonctionnels, ce qui suscite un remodelage cortical et un soulagement des douleurs neuropathiques. Des décennies de recherche et l’utilisation de différentes combinaisons de miroirs physiques et de réalité virtuelle ont permis d’améliorer et d’adapter cette thérapie.
Traitement amélioré du sarcome grâce à un inhibiteur de tyrosine kinase administré en combinaison avec une thérapie à base de lymphocytes T CAR de nouvelle génération
Projet de la Dre Antonia Digklia, Centre hospitalier universitaire vaudois, et de la Dre Melita Irving, Centre hospitalier universitaire vaudois.
Cet investissement a pour but d’aider l’équipe de recherche à produire les données et informations de base nécessaires à l’étude de l’utilisation de l’immunothérapie CAR-T de nouvelle génération dans le traitement du sarcome. La Dre Irving, chercheuse fondamentale spécialisée dans la production de lymphocytes T CAR, et la Dre Digklia, clinicienne travaillant au Centre des sarcomes du CHUV, contribuent à parts égales à ce projet. Dans des essais préliminaires de phase I/II, l’équipe a obtenu des résultats prometteurs suggérant qu’un inhibiteur de la tyrosine kinase VEGFR (pazopanib) administré en combinaison avec l’inhibiteur de point de contrôle anti-PD-L1 durvalumab pourrait enrayer le développement de sarcomes des tissus mous. Les chercheuses souhaitent combiner un inhibiteur de la tyrosine kinase (ITK) avec des thérapies innovantes à base de lymphocytes T CAR pour le traitement de sarcomes. Il s’agit d’un objectif ambitieux, mais il est raisonnable de tester tant les cellules T CAR que les thérapies à base d’inhibiteurs de points de contrôle. L’équipe de recherche espère se servir de l’EphA2, un marqueur de surface cellulaire spécifiquement surexprimé dans les sarcomes, comme cible pour de nouveaux lymphocytes T CAR. Il importe de comparer les biopsies prélevées chez les patients avant et après le traitement à l’inhibiteur de tyrosine kinase, afin d’être en mesure d’identifier les cibles les plus spécifiques pour la production des lymphocytes T CAR. La plupart des données préliminaires sont issues d’études faites avec des cellules de cancers de la prostate. Les fonds accordés ont donc également pour but de permettre à l’équipe de recherche de confirmer l’expression d’EphA2 dans les sarcomes avant et après le traitement ITK, et ainsi donner du poids à l’idée d’utiliser ce marqueur comme cible pour les lymphocytes T CAR.
Développement de systèmes d’IA pour aider à la stadification et au traitement des patients atteints de cancer de la vessie

Les cancers de la vessie (CV) sont généralement caractérisés comme étant superficiels ou invasifs. Comme pour tous les cancers, la tumeur doit être stadifiée afin d’établir un bon pronostic et de décider d’un traitement approprié. Actuellement, la stadification des tumeurs de la vessie dépend de la profondeur à laquelle la tumeur est imbriquée dans la paroi de la vessie. Cependant, des recherches récentes ont montré que cela ne reflétait pas nécessairement les caractéristiques les plus pertinentes sur le plan biologique des différentes formes de la maladie. L’objectif de cette collaboration est de mieux comprendre le comportement biologique du cancer de la vessie au niveau moléculaire et cellulaire, afin d’optimiser le processus de prise de décision pour un traitement efficace. Ce processus de prise de décision est sensible au temps, car le traitement doit commencer deux semaines après la prise de la biopsie.
Il est essentiel d’optimiser le processus de stadification lui-même, car la précision à ce stade aura un impact considérable sur le choix de la thérapie et la qualité de vie du patient. Le surtraitement et le sous-traitement des cancers peuvent tous deux entraîner de graves problèmes.
L’objectif global de ce projet TANDEM est d’explorer la nature biologique du CV grâce à une série de techniques moléculaires avancées à haut débit (génomique, transcriptomique, épigénétique) combinées à la surveillance des réponses fonctionnelles aux différentes thérapies. À partir de là, un atlas des types de cellules tumorales et des sensibilités sera créé, ce qui permettra aux chercheurs de générer un cadre d’IA qui devrait mieux guider les décisions de soins des patients atteints du CV. Les collaborateurs rassemblent différents types d’analyse pour faire la lumière à la fois sur la tumeur et ses tissus environnants (microenvironnement tumoral), et étudier la réponse du CV aux inhibiteurs chimiques in vitro. L’objectif est d’offrir une plateforme plus précise pour le diagnostic et la stadification des CV, permettant aux cliniciens d’associer les patients au traitement le plus efficace.
Développement d’une nouvelle thérapie pour les patients atteints d’un cancer colorectal résistant
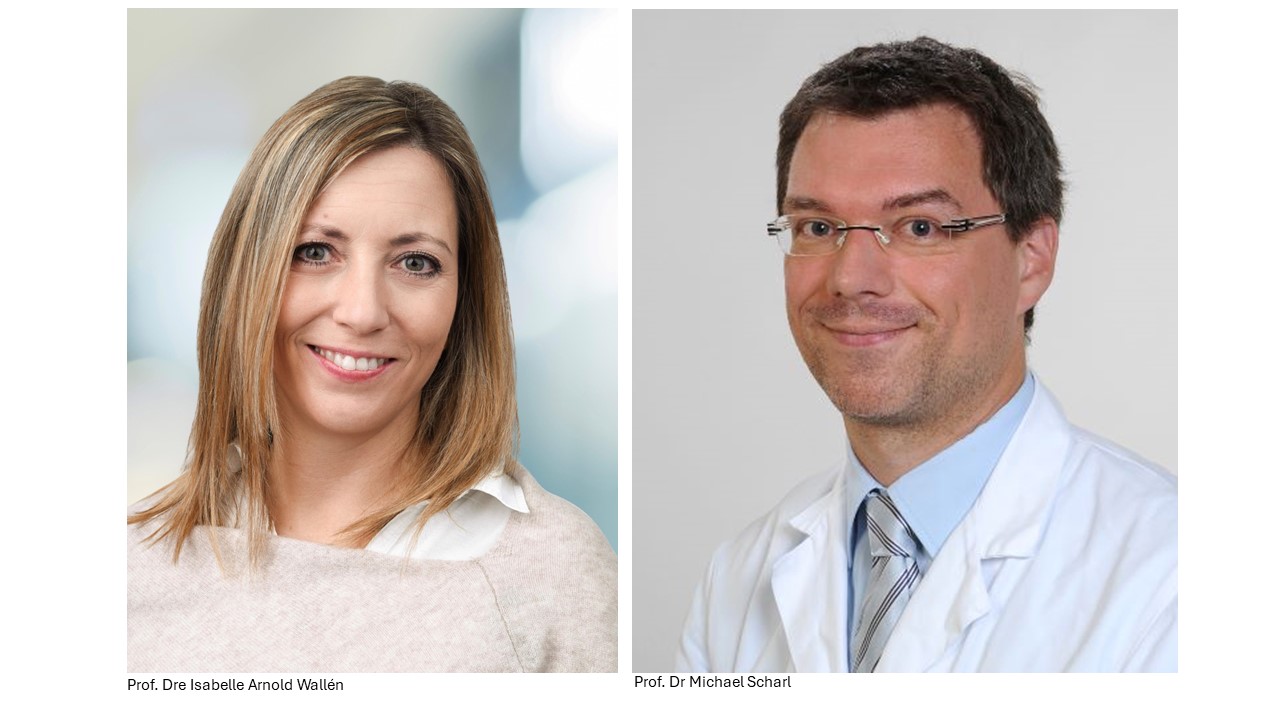
Le cancer colorectal (CCR) est le deuxième cancer le plus fréquent et est responsable des décès liés au cancer chez les hommes et les femmes à l’échelle mondiale. Même si les options thérapeutiques se sont améliorées, notamment grâce à l’introduction prometteuse des immunothérapies, seule une fraction des patients bénéficie des traitements actuels, voire y répond. Par exemple, la thérapie par inhibiteurs de points de contrôle ne profite qu’à 5 % des patients atteints de CCR jusqu’à présent. Cette collaboration vise à développer de nouvelles options thérapeutiques indispensables, en particulier celles qui sont adaptées à chaque patient, afin de garantir une efficacité et une sécurité accrues. L’objectif est d’améliorer la qualité de vie et le pronostic des patients atteints de CCR.
Il a été démontré que les patients atteints de CCR ont une composition modifiée du microbiote intestinal, qui peut contribuer à la pathogenèse du cancer, à la résistance au traitement et à l’augmentation de la toxicité des traitements anticancéreux actuellement utilisés. Des données prometteuses montrent maintenant que des bactéries spécifiques sont capables de moduler les réponses immunitaires antitumorales et peuvent donc servir d’agents thérapeutiques potentiels ou d’adjuvants pour de nouvelles thérapies. De nouvelles études ont établi un lien entre des niveaux plus élevés d’éosinophiles intratumoraux (un type de globules blancs ayant une fonction immunitaire spécialisée) et un pronostic favorable. Les niveaux d’éosinophiles sont en corrélation avec l’amélioration de la survie des patients atteints de CCR.
L’objectif stratégique de ce projet est d’approfondir la compréhension du microbiome du patient et de son interaction avec les éosinophiles afin d’explorer leur rôle potentiel en tant que biomarqueurs moléculaires susceptibles de prédire l’évolution de la maladie et la réponse au traitement. En fin de compte, cela pourrait conduire à une médecine de précision personnalisée basée sur le microbiote pour les patients atteints de CCR.
Enquête auprès de patient·e·s atteint∙e∙s de cancer sur leurs expériences de soins en Suisse
Ce « fonds affecté » a été attribué à Madame Chantal Arditi en juillet 2022 pour une durée de 2 ans (Unisanté).
Recueillir le point de vue et les expériences de soins des patient·e·s est essentiel pour évaluer la qualité des services de santé et pour déterminer dans quelle mesure le système de santé répond aux besoins des patient·e·s. Ceci est particulièrement important dans les soins aux personnes atteintes de cancer, car elles ont de multiples besoins de soutien, souvent non satisfaits par le système de santé actuel. En effet, en plus des effets de la maladie et des traitements sur la santé, le cancer peut avoir des conséquences psycho-sociales importantes pour les personnes touchées et leurs proches, y compris des conséquences financières.
En 2018, nous avons mené l’étude SCAPE-1 (Swiss Cancer Patient Experiences), une première enquête auprès de personnes traitées pour l’un des six cancers les plus fréquents dans quatre hôpitaux romands qui portait sur leurs expériences de soins oncologiques. En 2021, nous avons reconduit l’enquête, appelée SCAPE-2, qui a été étendue aux personnes atteintes de tout type de cancer et soignées dans les même quatre hôpitaux romands ainsi que dans quatre hôpitaux alémaniques. Le questionnaire comprend entre autres des questions sur le soutien émotionnel, l’information et la communication, la prise de décision concernant le traitement, et les soins hospitaliers et ambulatoires. Une section concernant l’impact du Covid-19 sur les soins et les personnes atteintes de cancer a été ajoutée au questionnaire.
Les résultats de l’étude donneront un aperçu de la manière dont les patient·e·s vivent les soins oncologiques et si ces expériences varient selon la langue et le centre de cancer. Les résultats permettront aussi de guider le développement et la mise en œuvre d’interventions locales et nationales visant à améliorer les soins oncologiques, en identifiant les aspects moins bien perçus par les patient·e·s.
L’étude SCAPE-2 a été financée initialement par le Recherche suisse contre le cancer. Le soutien supplémentaire de l’ISREC permettra d’analyser en profondeur les données collectées dans le cadre de l’étude SCAPE-2 et de les valoriser par la publication d’articles scientifiques ainsi que par des présentations lors de conférences et séminaires.
Personnalisation du traitement de patients atteints d’un cancer et détection de vulnérabilités des cancers
Ce « fonds affecté » a été attribué à la Prof. Chantal Pauli (Universität Spital Zürich) en juin 2022 pour une durée de 2 ans.
Les protéines RAS figurent parmi les éléments les plus importants de la voie de signalisation MAPK, une cascade de signalisation impliquée dans la croissance et la survie des cellules. Les gènes RAS modifiés (HRAS, KRAS et NRAS) représentent la famille de gènes la plus fréquemment mutée dans les cancers humains, KRAS étant responsable du développement d’environ 35% des adénocarcinomes pulmonaires, jusqu’à 50% des cancers colorectaux et même jusqu’à 95% des cancers du pancréas. Malgré d’importants efforts de recherche, l’inhibition efficace de KRAS muté demeure un obstacle majeur dans la lutte contre le cancer. Le développement récent de médicaments spécifiques à la mutation KRASG12C a permis de caractériser en partie ce variant particulier, mais le succès clinique de ces substances reste très limité, et de premières mutations conduisant à des résistances ont déjà été signalées. Vu que les efforts visant à inhiber KRAS n’ont pas porté de fruits, les travaux de recherche se concentrent maintenant sur l’inhibition de MEK1/2, un régulateur situé en aval de la voie de signalisation MAPK. Cependant, les mécanismes de résistance vont en augmentant, et la notion d’invincibilité des tumeurs présentant une mutation au niveau de KRAS persiste. Il est donc impératif de développer de nouvelles stratégies pour identifier les vulnérabilités des cancers.
A l’heure de la médecine de précision, tant les cliniciens que les patients dépendent de l’identification d’options de traitement additionnelles et du développement de stratégies permettant de confirmer l’efficacité thérapeutique. Le groupe de recherche en pathologie fonctionnelle des tumeurs, dirigé par la Prof. Dr. med. Chantal Pauli et situé dans le département de pathologie et de pathologie moléculaire de l’Hôpital universitaire de Zurich, a développé une plateforme intégrant les caractéristiques génétiques de tumeurs individuelles de patients et les tests fonctionnels d’organoïdes tumoraux dérivés de patients. L’objectif global est d’identifier des stratégies thérapeutiques efficaces pour chaque patient, en procédant à un criblage de médicaments anticancéreux. Cette approche a conduit à l’identification d’une nouvelle combinaison synergique de médicaments, dont un inhibiteur de MEK et un analogue de la purine. Chose intéressante, cette synergie n’a pas pu être détectée dans tous les organoïdes tumoraux, mais était limitée à ceux présentant une mutation au niveau de la voie de signalisation MAPK.
Ce projet examinera en outre le potentiel thérapeutique de cette combinaison médicamenteuse dans une cohorte plus importante d’organoïdes tumoraux dérivés de patients, et aidera à comprendre les caractéristiques génétiques liées à la vulnérabilité observée dans certaines tumeurs. Vu l’apparition progressive de mécanismes de résistance contre KRASG12C, nous prévoyons de tester si notre combinaison est en mesure de contourner les mécanismes de résistance et d’influer sur la viabilité des tumeurs. Enfin, nous chercherons d’une part à identifier les patients pouvant bénéficier de cette combinaison synergique de médicaments, et d’autre part à élucider les mécanismes de sensibilité ou résistance des patients aux médicaments.
Ce « fonds affecté » provenant d’une donation de la Fondation faîtière d’utilité publique Empiris a été attribué à la Prof. Caroline Arber (CHUV) en avril 2022 pour une durée de 1 an.
Ciblage de nouveaux réseaux moléculaires sous-tendant la récurrence et la progression du cancer de la vessie
Ce « fonds affecté » a été attribué à la Prof. Camilla Jandus (Université de Genève ) et au Prof. Grégory Verdeil (Université de Lausanne) en avril 2022 pour une durée de 2 ans.
Au niveau mondial, le cancer de la vessie (CV) est un problème de santé publique considérable, tant en termes de prévalence et de mortalité que de gestion clinique et de coûts. Pour la plupart des patients, à savoir environ 70%, la maladie est détectée à la surface de la vessie, à l’état de CV non invasif sur le plan musculaire (NMIBC). Depuis de nombreuses années, ce cancer est traité par instillation de BCG et par résection de la tumeur. Ce traitement est efficace, mais la plupart des patients subissent une récurrence de la tumeur et doivent se soumettre à plusieurs cycles de traitement au fil des ans. La maladie peut également évoluer vers un CV invasif sur le plan musculaire (MIBC, 30%). Le traitement consiste alors en une chimiothérapie et une ablation de la vessie (cystectomie). Malgré ce traitement radical, la survie est faible et la moitié des patients ne survivent pas au-delà de cinq ans. Lorsque la maladie est métastatique, la survie ne dépasse pas 15 mois. Ces dernières années, l’immense succès de l’immunothérapie a également permis d’améliorer le traitement du MIBC en restaurant la capacité du système immunitaire à combattre la maladie. 20 à 30% des patients traités avec des anticorps bloquant la voie de signalisation PD-1/PD-L1 répondent au traitement, mais le taux de réussite est plus faible que pour d’autres types de cancer. Afin d’être en mesure d’améliorer la stratégie thérapeutique et de trouver de nouveaux traitements immunothérapeutiques, il est donc indispensable de comprendre pourquoi de nombreux patients ne répondent pas au traitement.
Nous projetons donc de combiner l’expertise de nos deux groupes de recherche, dans le but de déchiffrer les mécanismes moléculaires activant la récurrence et la progression du cancer. Nous effectuerons des études avec des échantillons de patients ainsi qu’avec un modèle murin génétiquement modifié (MMGM) du CV récapitulant les stades de la progression du CV humain. En vue d’essais cliniques de phase 1 et 2 visant à améliorer la survie des patients, nous investiguerons et validerons également dans ce MMGM de nouveaux axes thérapeutiques et des biomarqueurs.
Des études génétiques préliminaires effectuées sur des tissus de tumeurs primaires et récurrentes issus d’une cohorte de 12 patients atteints d’un CV ont conduit à la découverte d’une signature génétique associée à la progression et la récurrence du CV. Dans notre étude, nous concentrerons notre attention sur deux voies de signalisation appartenant à cette signature et susceptibles d’être ciblées pour améliorer le contrôle et l’élimination de la tumeur. Nous avons pu démontrer, dans une cohorte plus importante de 36 patients, que ces deux voies de signalisation sont plus prononcées dans les tumeurs récurrentes que celles non récurrentes. Cette même signature a également été détectée dans le stade progressif de notre MMGM, ce qui confirme la pertinence clinique de ce modèle. Sur la base de ces résultats, nous formulons l’hypothèse de l’existence d’une interaction entre les cellules immunitaires et tumorales du CV, impliquant les gènes étudiés ainsi que leur régulation, et pouvant servir de cible thérapeutique.
Objectif 1
Par conséquent, le premier objectif de ce projet est de valider dans des échantillons de CV primaire issus de patients ainsi que dans notre modèle murin (coupes de tumeurs, tissus tumoral frais) la signature génétique de progression et récurrence au niveau protéinique. Cette étape nous permettra d’identifier les types de cellules (cellules tumorales, stromales, immunitaires (myéloïdes et lymphoïdes)) exprimant les gènes candidats.
Objectif 2
Notre deuxième objectif est d’inactiver nos gènes cibles ou leurs ligands dans chaque type de cellule. Nous observerons in vitro le comportement de cellules immunitaires génétiquement modifiées humaines et murines (phénotype, sécrétion de cytokines, stade de différenciation, plasticité) ainsi que celui de cellules tumorales de CV (survie, invasion, migration, formation de colonies, transition épithélio-mésenchymale). Nous évaluerons la survie des animaux, la progression in vivo et la composition du micro-environnement de tumeurs établies par instillation intravésicale de cellules de CV de type sauvage ou génétiquement modifiées. Nous étudierons également la dynamique de la croissance et la propagation des tumeurs dans les souris de type sauvage et génétiquement modifiées, ainsi que la survie des animaux et la composition du micro-environnement tumoral.
Objectif 3
Enfin, nous effectuerons des études précliniques avec des anticorps bloquants, de petites molécules ou des miARN mimétiques dans notre modèle murin de CV, afin de déterminer comment ces traitements influencent la progression tumorale et la réponse immunitaire contre la tumeur. Dans l’ensemble, nous espérons identifier de nouvelles voies de signalisation susceptibles d’être ciblées, afin d’augmenter nos connaissances à ce sujet et d’améliorer les stratégies de traitement pour les patients atteints d’un cancer de la vessie récurrent et avancé.

