Élargir le diagnostic du cancer grâce à l’analyse des ganglions lymphatiques
Déploiement clinique et validation d’un algorithme d’apprentissage profond multi-cancers basé sur des modèles de fondation pour la détection des métastases ganglionnaires

Cette étude repose sur une étroite collaboration entre l’informatique et la pratique clinique. La détection des cellules cancéreuses dans les ganglions lymphatiques des patients est essentielle à la prise en charge clinique du cancer. L’analyse de l’état de ces ganglions lymphatiques requiert les compétences d’un pathologiste. Il s’agit toutefois d’un travail fastidieux et prenant. Un outil de diagnostic assisté par ordinateur a donc été développé pour les aider dans cette tâche. Cet outil utilise l’apprentissage profond pour détecter les métastases au niveau des ganglions lymphatiques situés près du côlon. Les chercheurs vont désormais étendre l’apprentissage de cet algorithme aux ganglions lymphatiques de dix types de cancer, afin d’élargir l’utilité de l’outil dans la pratique quotidienne en oncologie hospitalière.
Ce que l’imagerie de la moelle osseuse peut nous apprendre sur la leucémie
DeepMarrow : étude du remodelage de la moelle osseuse après une chimiothérapie intensive comme facteur prédictif de la réponse dans la leucémie myéloïde aiguë
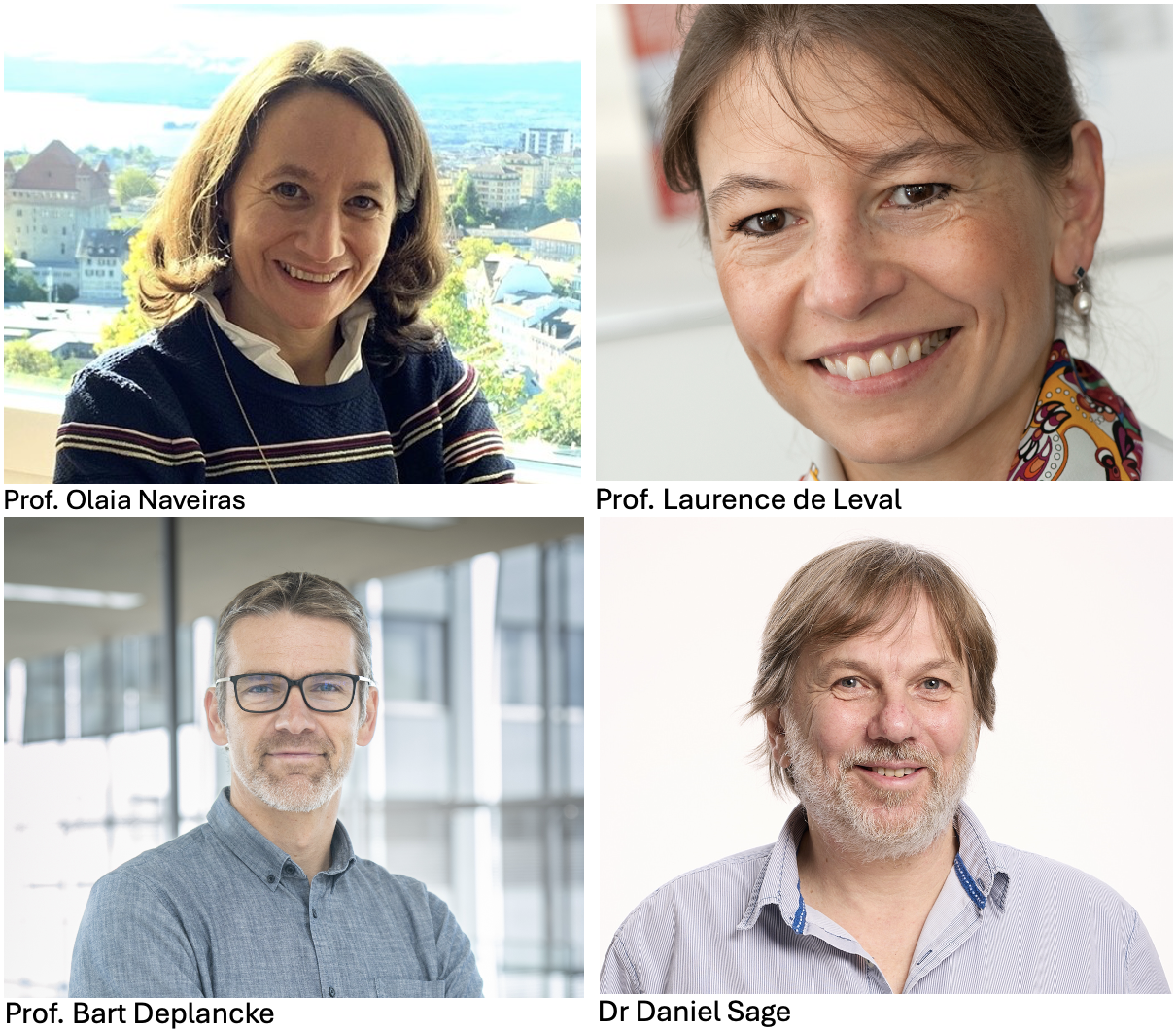
Dans la leucémie myéloïde aiguë (LMA), les modifications au niveau de la zone entourant la tumeur, appelée stroma, peuvent transformer les zones de production rapide de cellules sanguines en sites de croissance cellulaire pathologique, puis en leucémie manifeste. L’objectif de cette étude est de développer des outils numériques d’IA basés sur la pathologie des cellules sanguines qui permettront de quantifier les composants du tissu conjonctif dans la moelle osseuse. Cet outil pourrait également faciliter l’identification de patients atteints de LMA et présentant un risque élevé de rechute. Un tel outil devrait permettre de prédire et de prévenir les rechutes de la LMA, répondant ainsi à un besoin clinique clairement non satisfait.
Diagnostic d’un lymphome rare grâce à l’intelligence artificielle intégrative
Transformation du diagnostic des lymphomes ganglionnaires de la zone marginale par intégration de la pathologie numérique, de la biologie moléculaire et de l’intelligence artificielle
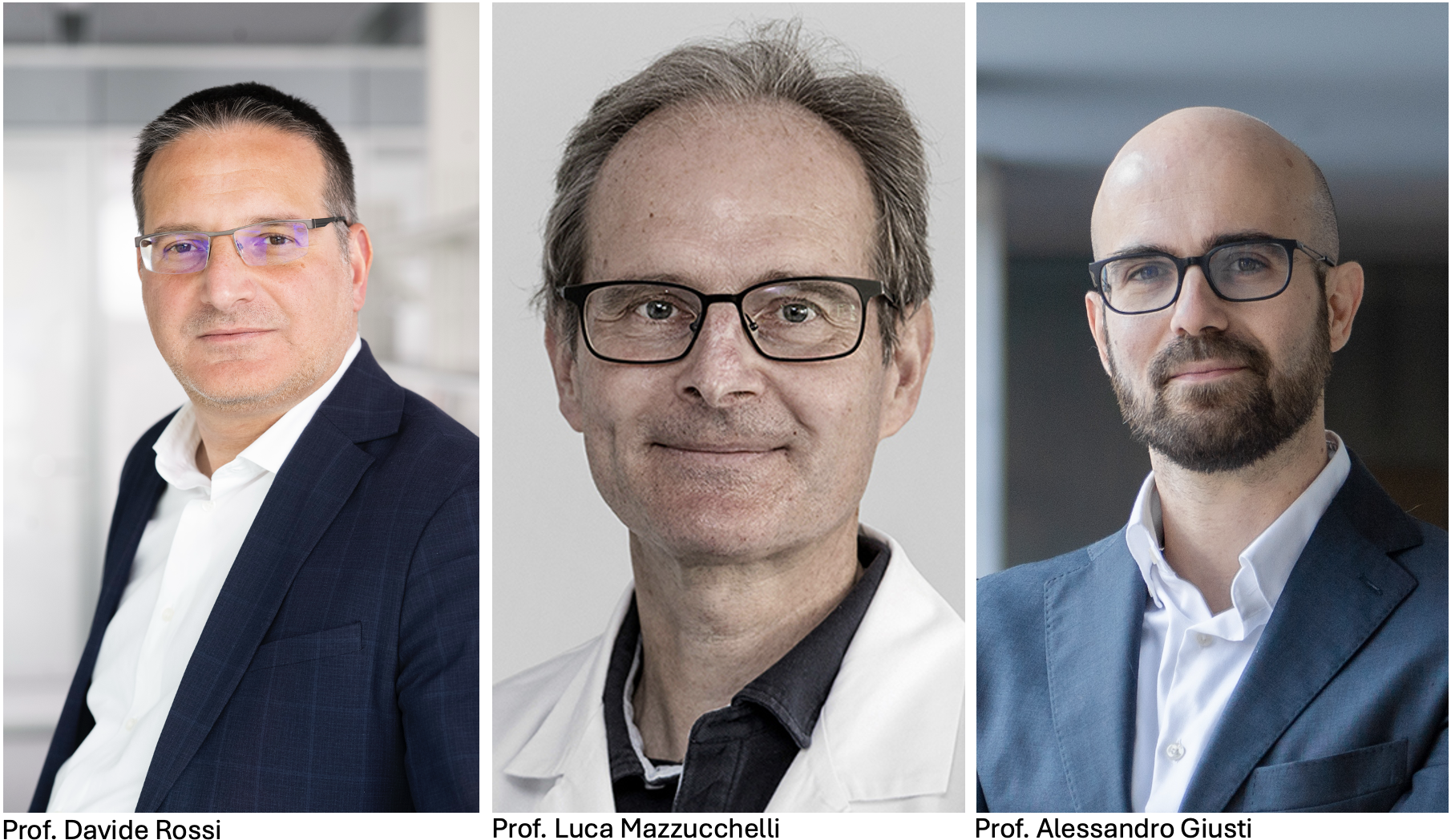
Le lymphome ganglionnaire de la zone marginale (LGZM) est une tumeur maligne rare et difficile à diagnostiquer, qui est souvent confondue avec d’autres pathologies. Les chercheurs proposent une approche de pathologie numérique qui, espèrent-ils, surpassera les pathologistes experts en matière de diagnostic correct du LGZM. Ils intégreront les données cliniques, moléculaires et d’imagerie à l’aide de l’apprentissage profond, dans le but de générer un classificateur qui permettra aux cliniciens de télécharger leurs scans de lames de tissus et d’obtenir un diagnostic correct du LGZM. Sur la base de 900 cas, d’échantillons et de données obtenus dans toute l’Europe, ils espèrent fournir une méthode cliniquement utilisable, mais techniquement sophistiquée, pour identifier un sous-type rare de lymphome.
Biologie spatiale au service de la stratification du risque de cancer du côlon
Stratification du risque de cancer du côlon à l’aide de l’imagerie et de profils de transcription

Pour identifier des biomarqueurs pronostiques pour les cancers colorectaux (CCR) de stade II, les chercheurs se serviront d’approches computationnelles pour combiner des données « omiques » moléculaires avancées avec des images histologiques provenant de 1800 anciens patients atteints de CCR. L’objectif sera d’identifier des marqueurs pronostiques dans des réseaux et de les valider sur de nouvelles cohortes de patients. Il s’agit d’un projet de pathologie numérique avancé.
La fibrose tissulaire déclenche-t-elle la récidive d’un cancer du cerveau ?
Analyse spatiale et interrogation fonctionnelle des zones de cicatrisation fibreuse dans la récidive du glioblastome
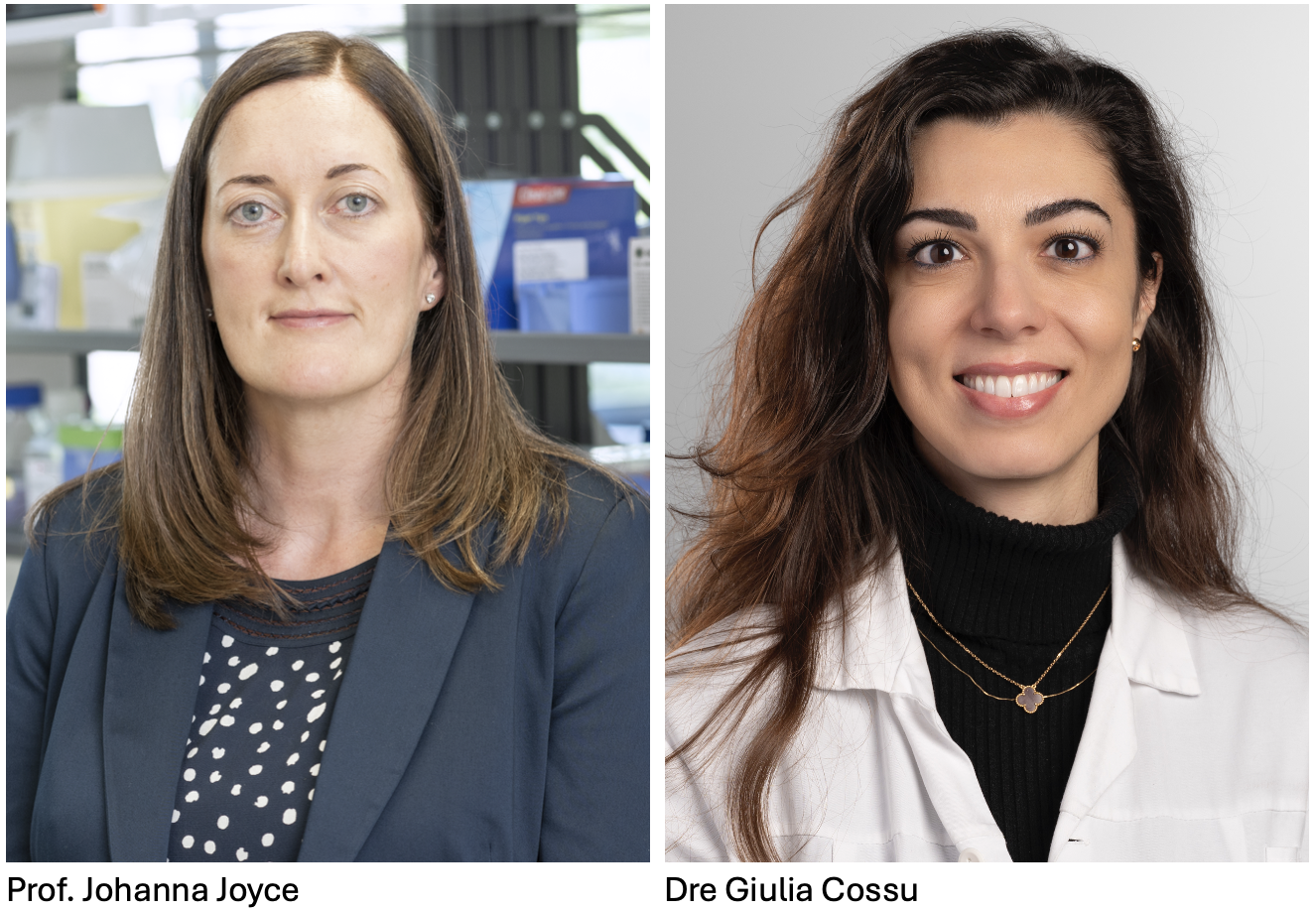
Les zones de cicatrisation fibreuse sont associées à la récidive tumorale dans les tumeurs cérébrales agressives. Cette étude associera technologies spatiales multi-omiques de pointe et analyses pathologiques numériques pour explorer les mécanismes à l’origine de la fibrose chez les patients atteints de glioblastome. À terme, les chercheuses espèrent découvrir de nouvelles cibles thérapeutiques capables de perturber la niche fibrotique protectrice de la tumeur et ainsi de prévenir la récidive de la maladie.
Distinguer les tumeurs primaires des métastases dans les poumons grâce à l’IA
Nodules pulmonaires tumoraux multiples : développement de méthodes de pathologie moléculaire et numérique rentables pour distinguer les cancers pulmonaires primaires multiples des métastases intrapulmonaires
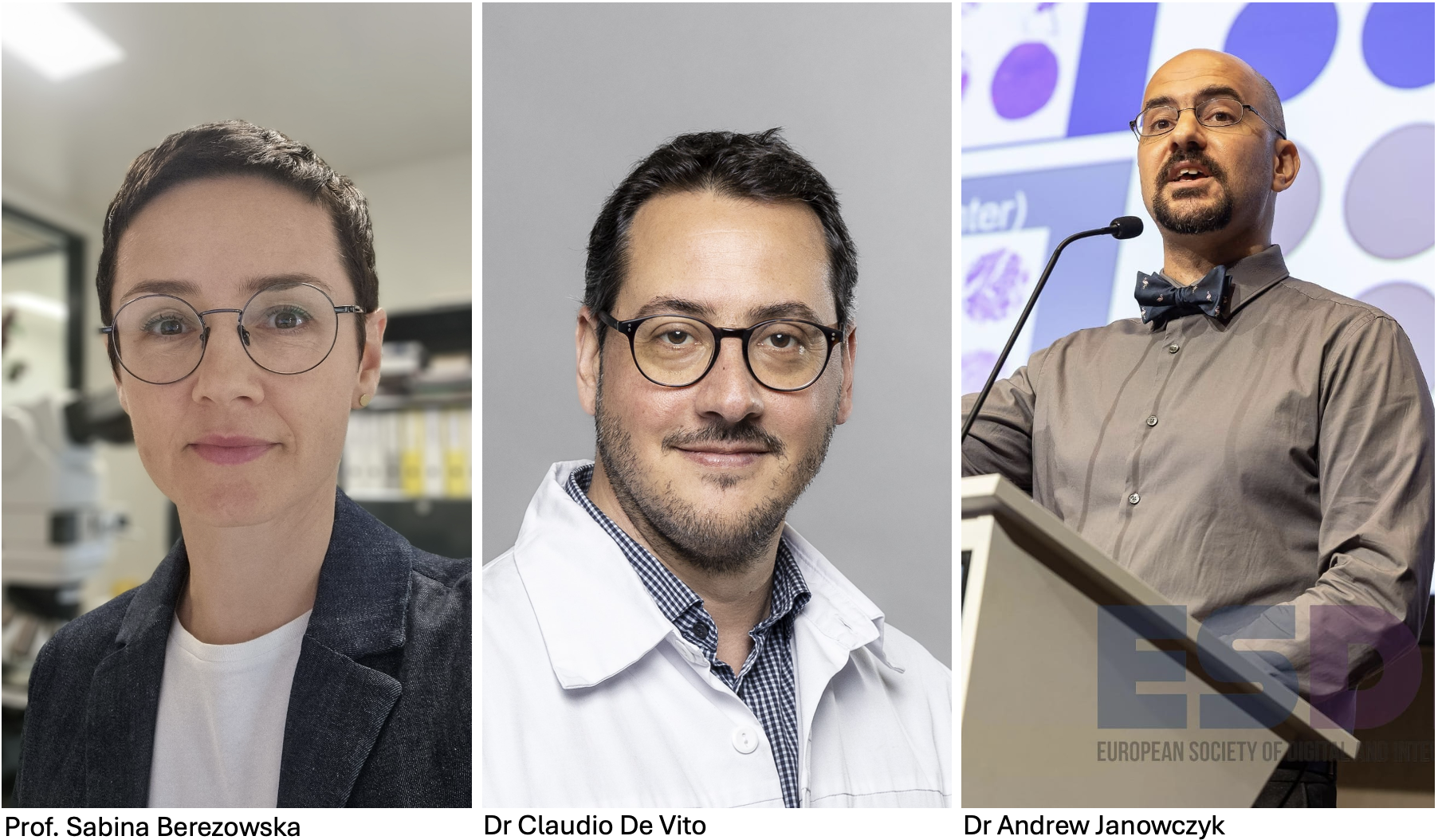
L’analyse au microscope des biopsies tumorales colorées est le domaine de compétence du pathologiste. Aujourd’hui, cette technique peut être améliorée et complétée par une analyse informatique et l’intégration d’informations supplémentaires.
À l’aide d’une vaste base de données de coupes tissulaires provenant d’adénocarcinomes pulmonaires primaires, cette équipe optimisera un nouvel outil de pathologie numérique (DPLAS) qui permettra de stratifier les cancers du poumon et de trier les patients. L’un des principaux atouts de cette technologie est qu’elle repose sur des lames H&E couramment disponibles, ce qui permet une large application de l’outil.
Prédiction optimisée de la compatibilité immunologique entre patients et donneurs pour la transplantation de cellules souches hématopoïétiques
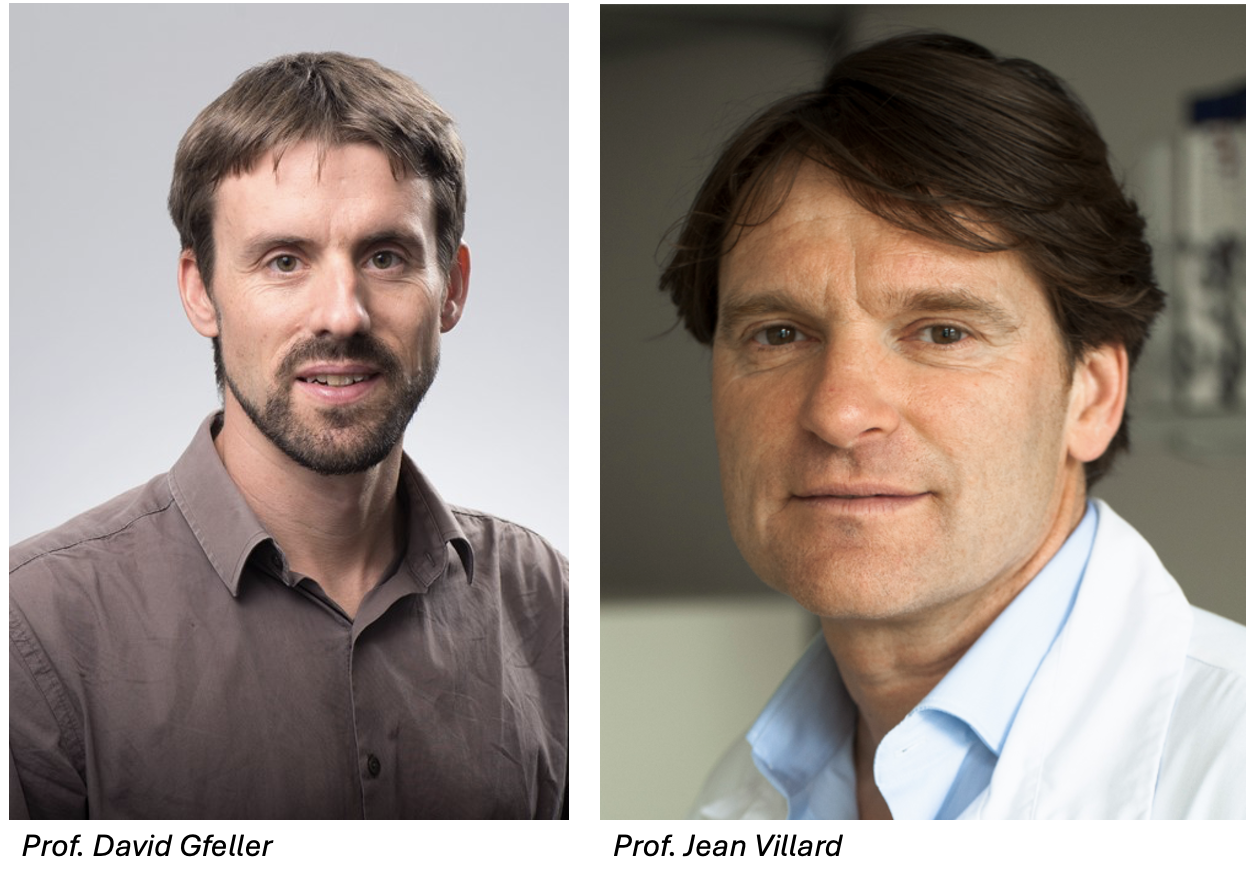
L’objectif premier du projet est d’optimiser la prédiction de la compatibilité génétique entre donneurs et receveurs pour la transplantation de cellules souches hématopoïétiques (TCSH) dans le traitement des malignités hématologiques. La compatibilité entre donneurs et receveurs est l’un des meilleurs indicateurs de réussite d’une TCSH. Les chercheurs visent à améliorer la précision de la prédiction afin de réduire l’incidence de la maladie du greffon contre l’hôte ainsi que d’autres complications liées au système immunitaire. Cette avancée pourrait potentiellement augmenter les taux de survie et améliorer la qualité de vie des patients devant subir ce traitement courant et essentiel.
Les Profs Gfeller et Villard s’appuieront sur des données immunopeptidomiques de pointe, des algorithmes d’apprentissage automatique et des données cliniques pour développer leur modèle de prédiction de la compatibilité génétique entre donneurs et receveurs. Ce modèle est conçu de manière à intégrer les résultats de transplantations effectuées dans le passé, ce qui permet d’améliorer continuellement sa capacité de prédiction. L’équipe de recherche prévoit de combiner ses résultats avec les connaissances médicales actuelles. L’objectif est de développer un outil robuste à usage clinique, facilitant les décisions en matière de sélection de donneurs.
Les lésions : moteur de la progression du carcinome basocellulaire ?
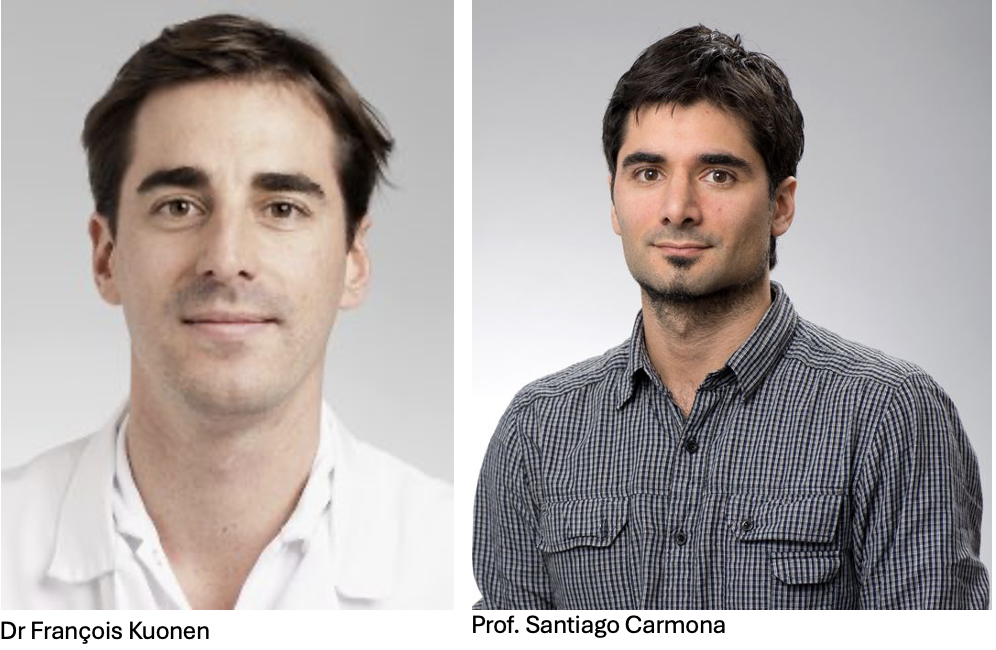
Ce projet, basé sur une approche de biologie des systèmes, vise à déterminer si les lésions subies lors de l’ablation chirurgicale du carcinome basocellulaire favorisent la progression de la maladie. Il servira également à étudier l’impact des lésions sur les nouvelles interventions thérapeutiques.
Le carcinome basocellulaire (CBC) est le cancer le plus fréquent chez l’homme. Bien que la plupart des CBC puissent être réséqués chirurgicalement, un certain nombre de tumeurs évoluent vers un stade invasif avancé, pour lequel il n’existe pas encore de thérapies efficaces. Nous émettons l’hypothèse que les lésions sont le facteur clé favorisant la progression invasive du CBC et que l’élucidation de ce mécanisme permettra d’améliorer les thérapies existantes. Nous proposons tout d’abord de caractériser les mécanismes par lesquels les lésions font progresser le CBC (en termes de plasticité des cellules cancéreuses, de remodelage du microenvironnement tumoral et de circuits d’interactions entre cellules). Nous prévoyons ensuite d’identifier des cibles moléculaires capables d’inverser la progression du CBC induite par les lésions et de surmonter la résistance aux thérapies. Pour ce faire, notre équipe de recherche multidisciplinaire combinera profilage transcriptomique spatial à l’échelle de la cellule unique, culture ex vivo de fragments tumoraux dérivés de patients et méthodes assistées par ordinateur.
Potentiellement, ce projet permettra d’élucider les mécanismes fondamentaux rattachant les lésions à la progression des cancers (non seulement le CBC, mais également d’autres types de cancer) et d’améliorer l’issue des traitements pour les patients atteints de CBC avancés pour lesquels les thérapies standard sont actuellement vouées à l’échec.
Améliorer le traitement du cancer colorectal pour prévenir les métastases
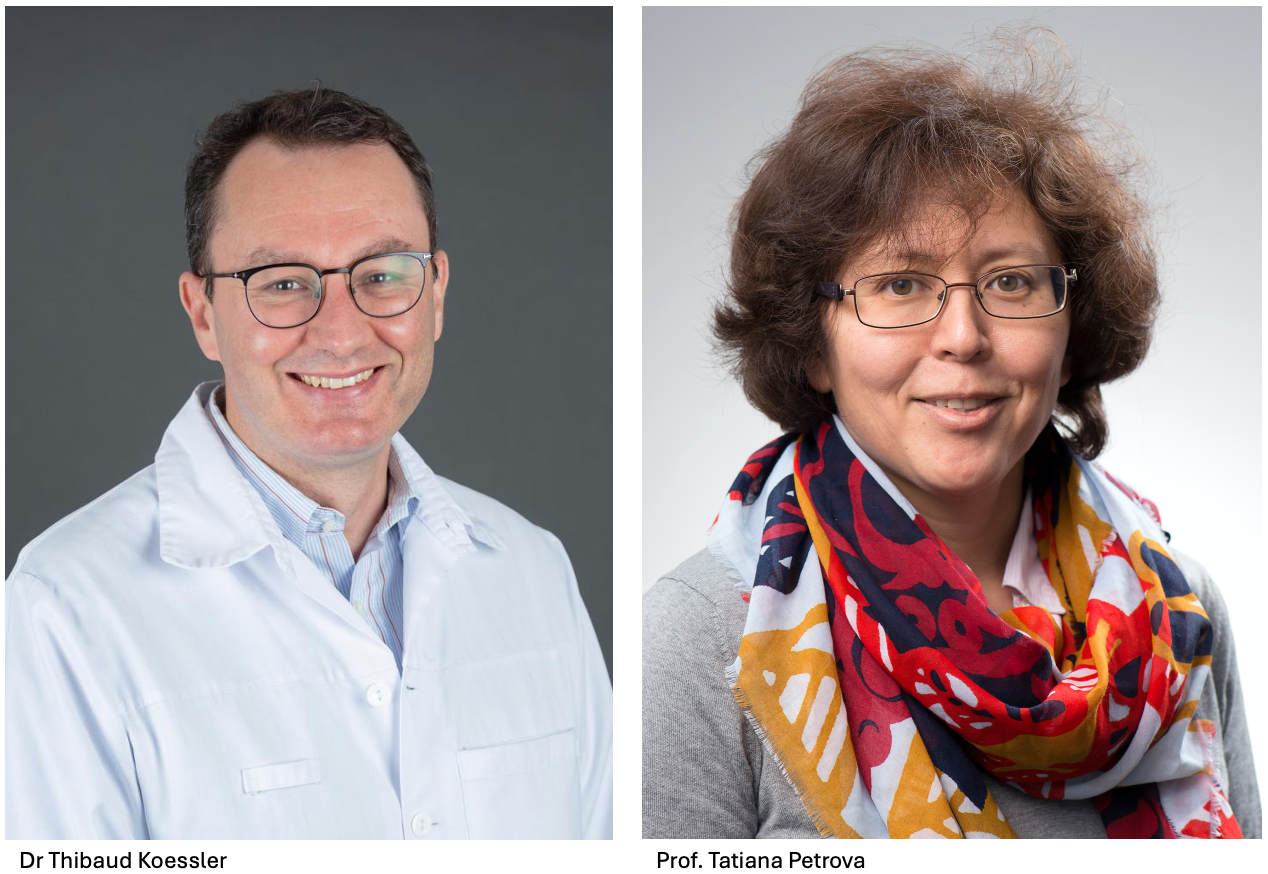
Le cancer colorectal (CRC) est l’une des principales causes de mortalité liées au cancer dans le monde, et la chimiothérapie reste le principal traitement pour les CRC de stade II et III. La chimiothérapie est une approche problématique, car tout en éliminant les cellules cancéreuses, elle attaque aussi des tissus sains tels que l’intestin ou le foie. On ne sait pas encore comment la chimiothérapie modifie la physiologie et la vulnérabilité de ces tissus. Des travaux récents ont démontré que la chimiothérapie provoque une libération de métabolites bactériens issus de l’intestin. Ces métabolites ont la capacité de prévenir les métastases du foie en stoppant la croissance métastatique et en reprogrammant la niche immunovasculaire du foie.
Dans le cadre de ce projet TANDEM, la Prof. Petrova et le Dr. Koessler collaboreront pour étudier le potentiel thérapeutique et diagnostique de ces découvertes pour les patients atteints d’un cancer colorectal. L’objectif des chercheurs est d’analyser les métabolites libérés en réponse à la chimiothérapie en identifiant la niche métastatique du foie et en examinant l’effet des métabolites sur des organoïdes (versions miniatures du foie cultivées in vitro) dérivés de patients.
Plus précisément, ils visent à :
- Etablir un profil des métabolites libérés en réponse à la chimiothérapie, tant chez des patients atteints de CRC que dans des modèles animaux.
- Caractériser les modifications au niveau de la niche métastatique du foie en réponse à la chimiothérapie et aux composants du microbiote intestinal.
- Analyser la manière dont agissent les métabolites libérés sur la croissance d’organoïdes dérivés de patients et sur la formation de métastases in vivo.
Ce projet fournira des informations concernant la manière dont la réponse des organes à la chimiothérapie est susceptible d’influer directement sur l’issue de la maladie. L’objectif translationnel du projet est de remédier au manque actuel de biomarqueurs pour la prédiction de la sensibilité de la chimiothérapie en clinique. Finalement, ce projet pourrait améliorer à la fois les outils diagnostiques et les options thérapeutiques.
Evaluation de la réponse spécifique aux néoantigènes des cellules T dans la carcinose pleurale traitée par chimiothérapie par aérosol hyperthermique intra-thoracique pressurisé de cisplatine (PITHAC)
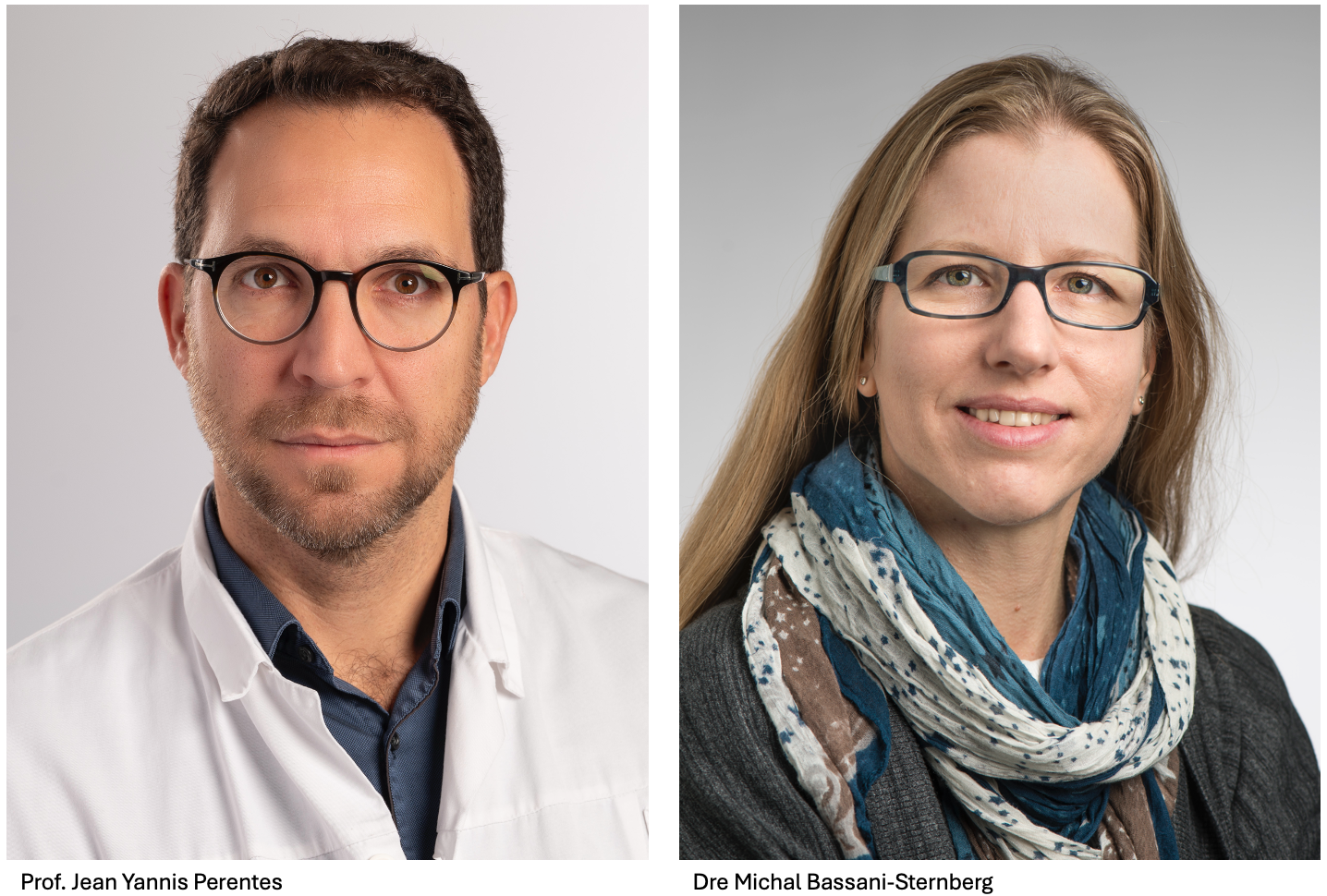
La carcinose pleurale se développe en dehors des poumons, dans la cavité située entre les poumons et la paroi thoracique et contenant un liquide lubrifiant, ainsi que le long du revêtement pleural, une membrane entourant les poumons et revêtant la cavité thoracique. Un cancer de la cavité pleurale est généralement le résultat d’une propagation à partir d’une autre partie du corps, le plus souvent à partir d’un cancer du poumon. Mais il peut également avoir son origine dans le sein, les ovaires, le pancréas, le côlon ou d’autres sites. Les tumeurs pleurales étant presque toujours métastatiques et difficiles à opérer, le pronostic est mauvais. Un patient sur quatre est encore en vie cinq ans après le diagnostic. L’incidence est heureusement faible : cette maladie touche un patient sur 2’000 personnes atteintes d’un cancer.
Une nouvelle approche thérapeutique pour la prise en charge de la carcinose pleurale, nommée PITHAC (pressurized intrapleural hyperthermic aerosol chemotherapy), associe l’administration localisée de médicaments sous pression à une stimulation immunitaire induite par la chaleur. On suppose que PITHAC déclenche une réponse immunitaire spécifique à la tumeur, mais l’efficacité de cette technique dans le cadre de la carcinose pleurale n’a été que peu étudiée.
Ce projet associe un clinicien spécialisé dans le traitement de la carcinose pleurale et une chercheuse experte en analyses biochimiques des protéines. L’objectif est de déterminer si la technique PITHAC induit de nouveaux antigènes à la surface des cellules tumorales, et si celles-ci, à leur tour, induisent une réponse spécifique aux néoantigènes dans le système immunitaire, notamment au niveau des lymphocytes T. Cette étude vise à caractériser le paysage antigénique dans les tumeurs de patients atteints d’une carcinose pleurale et permettra de déterminer si le mode d’action de PITHAC inclut l’induction d’une réponse protectrice des lymphocytes T, spécifique aux néoantigènes. Si tel est le cas, il serait raisonnable de combiner la technique PITHAC avec les immunothérapies, pour les rendre plus efficaces.
Les chercheurs appliqueront cette analyse aux patients participant à un essai clinique de phase I qui a débuté en 2023 au CHUV. Cet essai évaluera la faisabilité et la toxicité de PITHAC chez des patients atteint d’une carcinose pleurale. Des échantillons de sang et de liquide pleural seront prélevés (après l’intervention chirurgicale et périodiquement pendant un mois). Le subside TANDEM servira à financer l’analyse de ces échantillons. L’étude longitudinale de découverte d’antigènes, comparant les patients avant et après la thérapie, constitue l’aspect innovant de ce projet. Cette étude pourra potentiellement faciliter la combinaison de PITHAC avec des inhibiteurs de blocage de point de contrôle immunitaire, rehaussant ainsi l’impact translationnel du projet.

